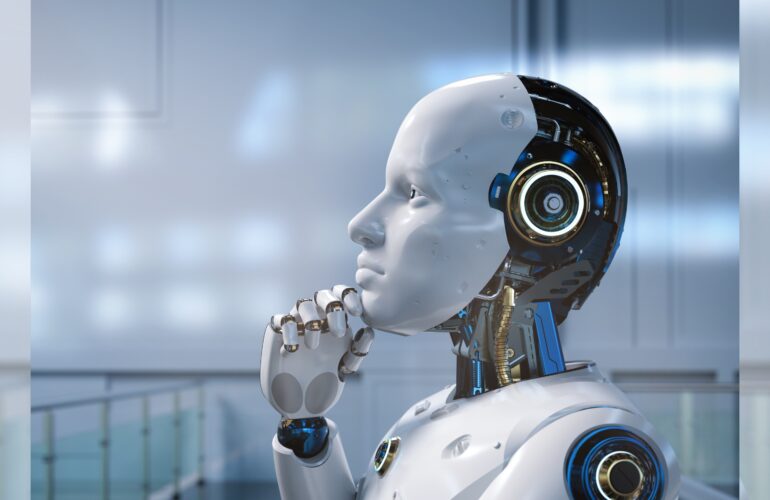Éduquer sans punir : est-ce possible ?
L’éducation sans punition, la discipline sans sanction sont-elles des options réalistes pour le développement de l’enfant ? Sont-elles applicables dans le cadre scolaire ? Quelles approches peuvent permettre d’éduquer sans avoir à recourir à des formes d’autorité parfois inefficaces, et le plus souvent frustrantes pour les élèves et les enseignants ?
L’idée qu’éduquer puisse s’exercer sans punition est peu partagée. L’absence de punition est pour beaucoup synonyme de laxisme et de perte d’autorité des parents et des enseignants. Beaucoup d’adultes, déplorant colères, caprices, mauvaises notes ou mauvais comportements, n’ont recours qu’à une seule solution pour tenter d’obtenir ce qu’ils souhaitent : la punition, et le plus souvent, la menace de punition… Or, si la punition peut avoir des objectifs nobles – bien élever, faire progresser, faire comprendre –, elle peut être, au mieux inefficace, au pire, traumatisante. Peut-on trouver une autre voie que celle-ci ? Comment éduquer sans punir ?
Plan de l'article
- La bonne correction fait la bonne éducation
- Rousseau, Montessori, Dolto, un apaisement salutaire
- De la permissivité à la responsabilité
- Éduquer, c’est transmettre un cadre
- Thomas Gordon, en finir avec le rapport de force
- Autodiscipline et droit à l’erreur pour l’enfant
- À La Jonchère, une autorégulation qui fait ses preuves
Punir vient du latin « poena » signifiant « peine ». Punir implique « d’infliger une correction, un châtiment à quelqu’un pour une faute commise par cette personne ». Elle induit que seul le châtiment – donc une source de peine – peut faire comprendre au fautif son erreur et faire en sorte qu’il ne la reproduise pas. La punition a eu longtemps de beaux jours devant elle ! Selon les époques, elle s’est inscrite dans un cadre de violence éducative, parfois insoutenable et ce pendant très longtemps. Rappelons-nous que la fessée n’a été interdite en France que par la « Loi relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires » du 2 juillet 2019… La bonne punition était déjà présente à l’époque néolithique de la sédentarisation de l’homme pour discipliner. Dans l’Antiquité, le père avait le droit de vie et de mort sur ses enfants. Mais cette façon d’éduquer avec violence n’était pas réservée aux parents. N’importe quel citoyen lambda pouvait infliger une punition physique à un enfant, sans lien de parentalité et sans raison fondée. Au Moyen-Âge, les enfants sont considérés comme des êtres nuisibles : coups de bâton, fessées, coups de verges (baguette pour frapper) font partie de leur quotidien. À cette époque, un enfant pouvait être fouetté tous les jours, comme ce fut le cas de Louis XIII jusqu’à l’âge de 13 ans… Ironie du sort, ce vrai « enfant-roi » fut maltraité sans autre forme de procès ! À l’école, plusieurs générations d’élèves ont étudié sous les coups de la férule du maître, petite palette de bois ou de cuir. Le martinet et la règle ont été également largement utilisés sur le dos et les doigts des enfants pour les faire obéir. Et ce, tout au long du XIXe siècle et début du XXe siècle. Ajoutons à cela le bonnet d’âne, la mise au coin, l’humiliation par les mots stigmatisant les « mauvais élèves » les « enfants désobéissants » et nous avons un bel aperçu des moyens coercitifs abusifs de l’éducation traditionnelle.
Autrement dit, des méthodes aux antipodes du développement des enfants épanouis et heureux.
Rousseau, Montessori, Dolto, un apaisement salutaire
Des courants de pensée totalement révolutionnaires ont permis de remettre en question le statut de l’enfant dans la société et par conséquent la place de la punition. Jean-Jacques Rousseau transmet, au siècle des Lumières, l’idée que « l’enfant est bon et naïf », ralentissant les passages à tabac dont il est souvent victime. Rousseau affirme que la nature est bonne et parfaite, et que c’est la société qui est corrompue. Si on veut éduquer de la meilleure manière, il faut suivre la nature et non pas les caprices de tout un chacun. Pour lui, l’éducation ne doit pas chercher à former un type d’homme ou de femme en particulier, mais bien l’homme et la femme dans leur essence même. Puisqu’il faut redécouvrir l’être humain naturel, l’éducation doit laisser l’enfant se développer librement sans entraver son développement. Bien plus tard, Maria Montessori et Françoise Dolto, entre autres, feront de l’enfant une personne à part entière, dotée d’intelligence et de qualité intrinsèques à respecter et à valoriser. Il convient donc d’éduquer sans punir pour aider l’enfant à grandir, apprendre et se développer.
À 8 ans seulement, Françoise Dolto affirmait : « Je veux être médecin d’éducation, pour faire comprendre aux parents ce que les enfants pensent ». S’appuyant sur le principe de liberté de l’enfant, Maria Montessori a prôné l’apprentissage par l’expérimentation et l’autonomie et ainsi révolutionné la pédagogie coercitive appliquée depuis des décennies. Ces nouvelles théories éducatives ont mis fin à une tradition de maltraitance et ouvert la voie de la pédagogie positive. Elles ont démontré que punir, gronder, ou simplement contrarier un enfant risquait de provoquer des troubles pour son développement : sentiment d’humiliation, sentiment d’impuissance, émotions négatives…
De la permissivité à la responsabilité
L’euphorie libertaire de mai 68 a surfé sur la vague de ces nouveaux courants de pensée. À cette époque, la punition doit être bannie. Il est interdit d’interdire ! Les parents autoritaires doivent apprendre à éduquer sans punir.
On assiste à l’apogée de la permissivité, à l’éclosion de la pédagogie anti-autoritaire inspirée de l’expérience d’Alexander Sutherland Neill fondateur de la Summerhill School en 1921. Dans l’école de Summerhill, les cours sont facultatifs, les enfants peuvent jouer toute la journée, les soirées sont consacrées à la danse, au théâtre, aux fêtes, toutes les décisions sont discutées de manière démocratique et adoptées en assemblées générales hebdomadaires. Cette expérience exclut bien entendu toute forme d’interdictions, donc toutes formes de sanctions et de punitions. Pour ce psychanalyste, seule la répression est mauvaise, et le fait de céder à la force conduit l’enfant et l’adulte à n’avoir l’un pour l’autre que de la haine ou du mépris. L’expérience de Summerhill a permis de déconstruire les relations de pouvoir à l’intérieur de l’institution éducative dans une perspective très individualiste. Mais si cette approche éducative très libérale a permis de supprimer la discipline, elle en a peut-être trop exclu l’instruction, cadre indispensable au vivre ensemble et à la citoyenneté.
Il convient donc de trouver le juste équilibre entre l’éducation punitive et l’attitude laxiste.
Éduquer sans punir, c’est transmettre le cadre
Si l’on considère l’éducation de l’enfant comme un moyen de développer son potentiel et de lui transmettre les moyens de devenir un adulte libre et responsable, un cadre bienveillant est important. Valeurs, règles, repères constituent alors les piliers pour comprendre le monde qui l’entoure. L’éducation positive vise son adaptation harmonieuse au milieu social et à ses évolutions. L’enfant qui n’a pas accès à ces repères peut développer de l’anxiété, des phobies de l’école, de l’intolérance, de l’omnipotence…
Il convient donc de poser des limites claires permettant à l’enfant de gagner confiance en lui et de s’adapter à sa future vie d’adulte. Mais attention, le cadre ne peut être respecté que s’il est bien compris. D’où l’importance de la transmission, de l’accompagnement, de l’explication, de l’empathie, de l’écoute bienveillante. Lorsqu’un enfant est forcé de faire quelque chose qu’il ne veut pas faire ou qu’il ne comprend pas, il se concentrera davantage sur sa colère envers les adultes plutôt que sur l’apprentissage d’une leçon de vie. Dans le contexte où la règle n’est pas comprise et intégrée, la punition vient ajouter à la peine comme une frustration. C’est pourquoi elle devient inefficace.
Que ce soit à l’école ou à la maison, il est donc primordial d’apprendre à éduquer sans punir pour garantir le développement et l’épanouissement des enfants et adolescents.
Thomas Gordon, en finir avec le rapport de force
La punition induit une règle, une transgression, un jugement, une sanction. Cela implique une faute originelle, le jugement de cette faute et le châtiment. Pour Thomas Gordon, chantre de la psychologie humaniste, disciple de Carl Rogers, nommé trois fois Nobel de la paix, ces éléments instaurent de fait un rapport de force entre l’adulte et l’enfant : on estime que seul l’adulte sait, et que pour transmettre le savoir à l’enfant, il doit installer une autorité pour que ce dernier intègre la règle ou exécute les ordres… Or, le rapport de force « brise la relation de confiance entre l’adulte et l’enfant ». Pour Thomas Gordon, il s’agit avant tout de restaurer la confiance à travers une méthode de communication non-violente permettant l’expression des besoins et des émotions. Cette communication réitérée permet à l’enfant de se responsabiliser en lui donnant la parole, tout en lui donnant les moyens de comprendre le cadre, de l’intégrer et de les respecter à son propre rythme. Dans cette approche, l’adulte reste le modèle(encore faut-il qu’il le soit !) et facilite l’apprentissage car « Il n’existe pas d’autre éducation intelligente que d’être soi-même un exemple » a dit Albert Einstein.
Autodiscipline et droit à l’erreur pour l’enfant
Même si nous posons et répétons clairement le cadre, les valeurs et les règles, l’enfant peut résister, les défier, les transgresser. Dans le cadre d’une pédagogie bienveillante, plutôt qu’une faute à punir, la transgression sera considérée comme une erreur à rectifier. Si nous acceptons de déplacer le sens de la « faute » sur le sens de l’ « erreur », nous modifions toute l’approche coercitive. Or « les erreurs sont de formidables opportunités d’apprentissage » comme le dit Jane Nelsen, psychologue et éducatrice américaine. Ajoutons à cela l’exemple, la répétition et nous conduisons naturellement l’enfant à s’auto-corriger, s’autodiscipliner. Le gain de maturité est inestimable dans cette démarche et le cercle devient vertueux : plus l’enfant (ou l’adolescent) est responsabilisé dans la confiance, plus il mûrit, plus il respectera les règles. L’autodiscipline apporte une plus grande satisfaction aux adultes et réduit les troubles chez les jeunes, augmentant leur estime d’eux-mêmes, leur sens de l’initiative ainsi que leur réussite sociale et scolaire.
Éduquer sans punir devient alors une excellente manière de transformer de jeunes enfants (parfois un peu turbulents) en adultes responsables et matures.
À la Jonchère, une autorégulation qui fait ses preuves
Sans sanctions, sans notes, sans punitions… Le collège-lycée La Jonchère s’enorgueillit de faire grandir ses élèves dans la bienveillance sans toutefois transiger sur le respect des valeurs et sur le travail scolaire.
L’école a pour cela mis en place des outils de médiation entre pairs, le mentoring entre élèves et forme les enseignants, les élèves et leurs parents à la méthode de communication interpersonnelle de Thomas Gordon.
Dans cette pédagogie, les enseignants sont sur un pied d’égalité avec les élèves : pas de rapports de force, pas d’autorité, mais une relation de confiance et d’assertivité. Au bout de quatre années d’existence, l’équipe pédagogique constate avec satisfaction que les élèves s’entraident, s’auto-disciplinent et parviennent, en grandissant, à se sentir responsables de leurs apprentissages. Dans ce contexte, il est facile de comprendre qu’au collège-lycée La Jonchère, la punition ne trouve pas sa place dans l’éducation des enfants !