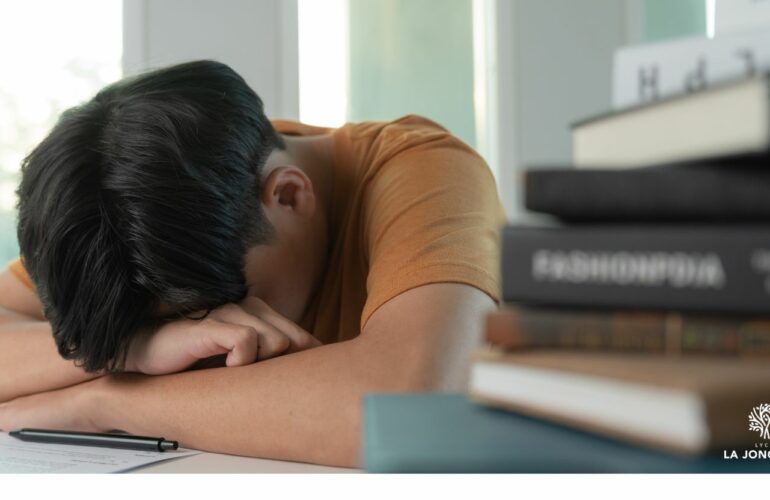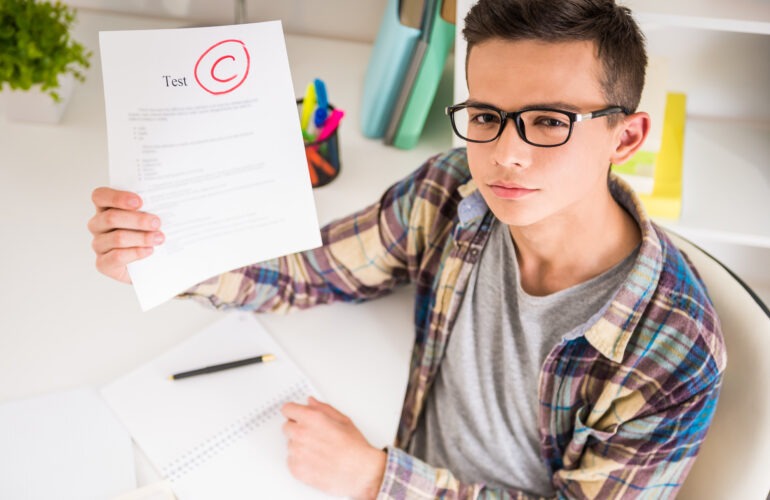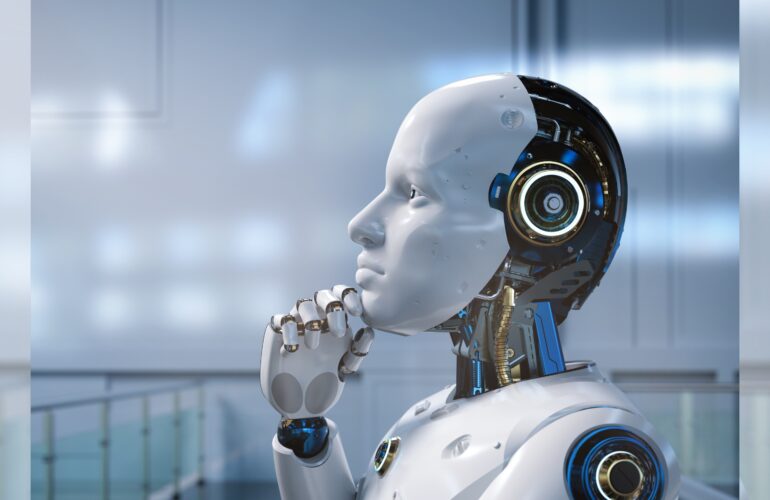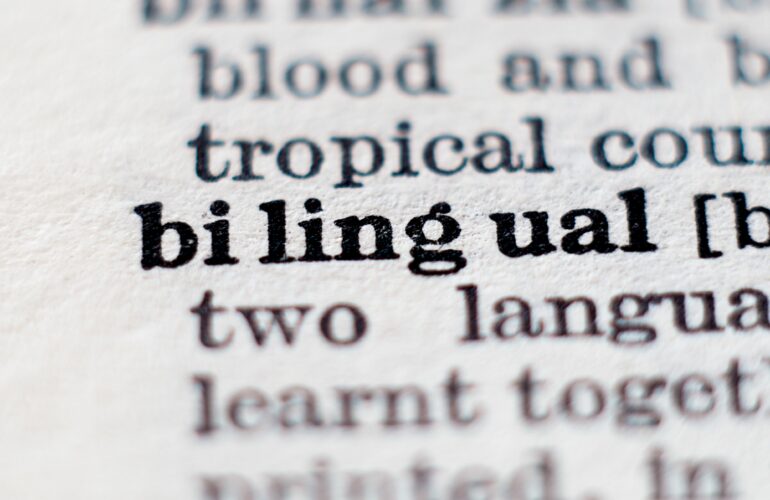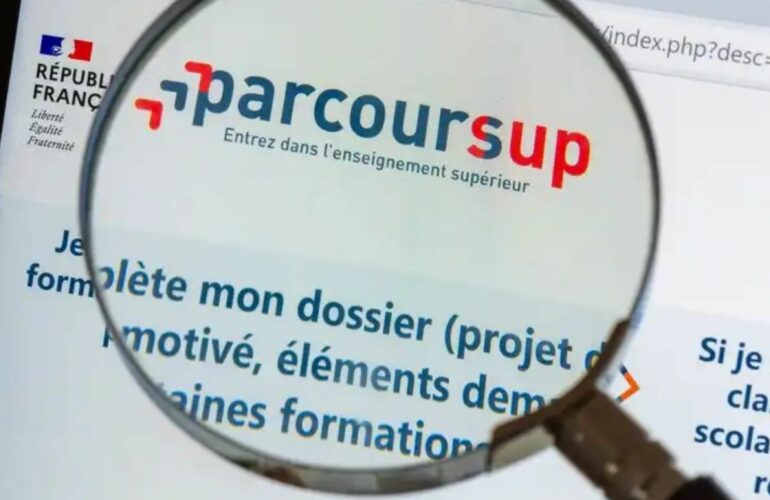Comment définir les critères de réussite scolaire?
Si nous devions illustrer l’idée de réussite scolaire des élèves, nous tracerions d’instinct une ligne droite bien jalonnée : les bonnes notes, le passage en classes supérieures, la moyenne au brevet et l’obtention du baccalauréat. Interrogez un enfant sur la définition de la réussite scolaire et vous obtiendrez à 90 % une réponse sur les résultats, les bonnes notes et les bonnes moyennes ! La réussite scolaire est donc largement associée à la performance scolaire et dans une autre mesure à la gagne dans un esprit de compétition. Quels sont les facteurs qui facilitent cette forme de réussite scolaire ? Cette vision partagée par le plus grand nombre laisse-t-elle place à d’autres dimensions de la réussite scolaire ?
Plan de l'article
C’est la forme de l’école elle-même qui détermine les caractéristiques de ce qui est considéré comme réussite éducative et comme échec à l’école. Depuis des siècles, l’école est organisée en cursus immuable : les cursus préscolaire et scolaire constitués eux-mêmes de degrés successifs, de la maternelle au lycée en passant par le primaire et le collège. Chaque degré est rythmé par des classes d’une année chacune, dessinant un parcours balisé, repérable pour des générations d’enseignants, d’élèves et de parents. Cette forme scolaire soumet le passage de l’élève à la classe et au degré supérieurs à la réussite d’une évaluation continue des acquis. L’apprentissage est codifié, les élèves sont soumis à des évaluations et des contrôles réguliers : contrôle des présences, contrôle des comportements, contrôle des performances individuelles, contrôles oraux et écrits, classements des uns par rapport aux autres. Dans ce contexte disciplinaire et normatif, il est évident que les indicateurs de la réussite des études se définissent à travers les bonnes notes, examens, bulletins et plus tard les diplômes. Le redoublement, les mauvaises notes et/ou l’absentéisme caractérisent plutôt les élèves en échec ou en difficultés scolaires.
L’environnement familial, social et économique : premier facteur de réussite scolaire
Psychologues, pédagogues, sociologues ont défini les facteurs de la réussite du parcours scolaire soumis à cette validation par les résultats. Parmi les facteurs d’inégalités scolaires, le milieu social et l’influence du milieu familial sont déterminants pour l’adaptation et l’adhésion de l’enfant à la structure scolaire. Plus les parents sont cultivés, diplômés, aisés, plus leurs enfants intègrent la culture de l’école et n’ont pas de difficulté à s’adapter à l’environnement scolaire et aux consignes et normes imposées. À l’inverse, un enfant grandissant dans un milieu moins favorisé, moins ouvert à la culture, dans lequel les difficultés matérielles prédominent, devra davantage se battre pour se sentir à l’aise dans l’environnement scolaire. Les facteurs environnementaux sociaux et socio-économiques seraient donc les premiers à jouer de leur influence pour faciliter la vie scolaire d’un enfant et aboutir à sa réussite. Mais ces facteurs ne sont pas les seuls, heureusement !
Des motivations extrinsèques pour stimuler la réussite
Dans le contexte d’évaluations et d’exigence de résultat scolaire, la stimulation par la promesse de récompenses – bonnes notes, reconnaissance du côté des enseignants, cadeaux, sorties voyages du côté des parents – peut procurer les clés de la réussite pour les jeunes. C’est ce qui caractérise la motivation « extrinsèque » : l’élève réagit à l’injonction d’obtenir de bons résultats pour obtenir la récompense, éviter la punition et accéder au graal de la reconnaissance définie par les adultes, la communauté éducative (enseignants), parents d’élèves et parfois même par les pairs (camarades de classe). Dans ce système de motivation extrinsèque, l’enfant, puis l’adolescent (collégien et lycéen), et enfin l’adulte, est toujours stimulé dans sa motivation pour obtenir diplômes et plus tard emplois. Dans ce système plutôt efficace, on peut toutefois déplorer que l’individu soit placé dans une position de réponse aux attentes et injonctions et que, dans ce contexte, il réagisse plutôt qu’il n’agisse.
Le contexte scolaire : un moteur pour l’intégration
Autre facteur externe de la réussite académique: le contexte de l’établissement scolaire. L’ambiance positive d’une école, d’un collège ou d’un lycée, et la bienveillance des équipes pédagogiques sont capitales pour motiver un enfant à bien appréhender les objectifs et les attentes en termes de résultats et de comportement. Plus l’environnement scolaire est agréable, plus les enfants s’y sentiront bien et s’intégreront facilement. Ce rôle est essentiel notamment au moment de l’adolescence, période sensible où émotions et sentiments extrêmes peuvent aboutir à un rejet total de l’institution et conduire au décrochage scolaire. Professeurs, éducateurs et équipes d’encadrement ont donc une grande responsabilité dans la création d’un climat scolaire favorable pour accueillir et motiver les élèves. Dans le cadre d’une pédagogie positive, renforcer l’estime de soi de l’enfant peut faire des miracles dans son parcours, quelle que soit son origine sociale et familiale. Il s’agit alors d’encourager, soutenir l’enfant en soulignant ses points forts et ses succès plutôt que ses erreurs, en favorisant un climat d’amour et de confiance.
La motivation et le désir d’apprendre de l’enfant lui-même : une chance à saisir
D’autres facteurs de réussite plus inhérents à la personne elle-même, viennent soutenir la réussite scolaire. D’où qu’il vienne et quel que soit son milieu social et familial, un enfant peut développer une motivation qui n’appartient qu’à lui-même, c’est ce qu’on appelle la motivation intrinsèque. Définie en 1975 par le psychologue américain Edward Deci, cette motivation n’est mue que par la recherche du plaisir, celle qui est activée dans le but d’obtenir une satisfaction personnelle. Le fait même d’accomplir cette activité comble celui qui l’exerce et la récompense externe (félicitations, prime…) ne représente pas un moteur. Un enfant peut développer de lui-même une réelle curiosité au monde, une passion pour la lecture, un intérêt pour les sciences, l’envie de créer des objets… Quelle chance ! Si de plus, elle est encouragée et soutenue par l’entourage, cette motivation est une voie royale pour la réussite dans les apprentissages.
Les intelligences innées : des moteurs de réussite
Aujourd’hui tout le monde est à peu près d’accord sur le fait qu’il existe de multiples intelligences. Chacun d’entre nous est doté de ses propres compétences et intelligences riches, intéressantes et utiles pour bâtir sa vie. Ces intelligences multiples, c’est le psychologue américain Howard Gardner qui les a définies en 1983. Selon cet éminent spécialiste, l’humain possède un spectre large : l’intelligence logico-mathématique, l’intelligence linguistique, l’intelligence spatiale, l’intelligence intra-personnelle, l’intelligence sociale, l’intelligence corporelle-kinesthésique, l’intelligence musicale, l’intelligence naturaliste et l’intelligence spirituelle. Chacune de ces formes d’intelligence peut aider un individu à se hisser sur l’échelle des apprentissages et lui ouvrir les voies du succès dans sa vie. En revanche, toutes ces compétences ouvrent-elles la voie à la réussite scolaire ? Le constat est que, au sein du système d’éducation français, seules les intelligences logico-mathématique et linguistique sont considérées comme les critères d’évaluation de générations d’élèves et ce depuis des siècles !
La notion de réussite scolaire revisitée
Nous sommes tous différents, nous apprenons tous différemment, à des rythmes différents. Peut-on décider qu’un enfant « mauvais » ou « moyen » en maths et en langues est un enfant mal parti dans la vie ? Réussir à l’école signifie- t-il réussir sa vie ? Trop d’adultes déplorent avoir été en situation d’échec, de rejet, de phobie scolaire, « avoir détesté l’école »… Et pourtant, sont-ils pour autant en échec dans leur vie ? Ne place-t-on pas trop d’espoir et de besoins de réassurance dans nos résultats scolaires comme s’ils étaient les seuls repères de notre avenir ? La notion de réussite scolaire peut être polysémique et multidimensionnelle. Si l’on s’écartait du chemin traditionnellement jalonné de notes, sanctions et récompenses, peut-être parviendrait-on à faire éclore d’autres formes d’intelligences, moins conformes aux exigences scolaires mais tout aussi valables pour l’épanouissement de l’enfant ?
Les critères de réussite au lycée La Jonchère
Ni carotte, ni bâton au lycée alternatif La Jonchère puisque les élèves n’ont ni notes, ni sanctions tout au long de leur scolarité. Les enfants sont pourtant bien suivis dans leurs apprentissages à travers une forme de coaching individualisé. Chaque semaine, chaque élève fait le point avec un enseignant sur ses acquisitions mais aussi sur ses émotions, comportements, besoins… Cet échange est une manière de consolider sa confiance en l’école à travers une forme de bienveillance et d’écoute. Si un enfant est en difficulté sur certains apprentissages, il ne subit aucune pression, l’idée étant que chacun prenne le temps qu’il lui faut pour progresser, quelle que soit la matière. Ni jugé, ni sanctionné, l’élève est encouragé, rassuré, conforté et au fil des années, progresse de façon spectaculaire, trouvant lui-même ses propres motivations pour apprendre. La réussite au lycée La Jonchère passe alors par la compréhension des valeurs de l’établissement, la relation pacifique avec les autres, l’entraide et la confiance. Et certains élèves y épanouissent leurs talents avec beaucoup de bonheur.