Inégalités scolaires en France : encore trop de freins à la réussite
Le système éducatif français se heurte à deux courants contraires. D’un côté le principe d’égalité d’accès à l’instruction et à la culture pour tous, consacré comme « devoir de l’Etat » par la Constitution française, de l’autre, l’accroissement factuel constant des inégalités scolaires limitant l’accès aux études supérieures d’une grande partie des apprenants. Comment expliquer ces inégalités de fait ? Comment sont-elles creusées au sein même du système ? Quelles pistes éducatives peuvent permettre de donner plus de chances à tous ?
Pour certains des parcours scolaires chaotiques, pour d’autres un chemin plus ou moins tranquille vers le bac… Les écarts de réussite entre les élèves ont toujours existé et ont toujours questionné les politiques éducatives de notre pays. Globalement, les origines de ces inégalités de niveaux et de parcours prennent racine dans les différences de niveaux socio-économiques. Les enfants de parents cadres, professions intermédiaires ou indépendants réussissent en effet davantage leurs études et sont plus nombreux à être bacheliers que les élèves issus de milieu social moins favorisé. Et même si ces derniers ont réussi à s’ouvrir l’accès à l’enseignement supérieur au fil des générations, les inégalités scolaires sont encore très marquées aujourd’hui.
Plan de l'article
Tous les trois ans, l’étude du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), piloté par l’OCDE, réitère des conclusions assez alarmantes sur les inégalités scolaires en France. Et surtout, le PISA confirme un fait propre à notre pays : davantage que dans les autres pays de l’OCDE, les inégalités scolaires reposent sur les conditions socio-économiques des élèves.
« La France est l’un des pays de l’OCDE où le lien entre le statut socio-économique et la performance dans PISA est le plus fort », précise la dernière étude publiée en 2018. Encore plus éloquent, parmi les élèves ayant de bons résultats dans PISA, un sur cinq ne prévoit pas de faire des études supérieures quand il vient d’un milieu défavorisé alors que cette proportion est très faible quand il vient d’un milieu favorisé.
Un double constat s’impose : les élèves issus de classes socio-économiques moins favorisées ont des résultats plus faibles, et même s’ils sont bons, affichent moins d’ambition pour poursuivre des études supérieures. Les inégalités sont donc bien creusées et accentuées par l’origine sociale des élèves. Ce qui pose un problème de société suivant : comment le système éducatif peut-il corriger ces déterminismes sociaux et appliquer le principe d’une école juste, valorisant les élèves au mérite et non selon leur origine sociale ?
Des inégalités accentuées par les approches éducatives
Si la société est le terrain des inégalités sociales, économiques et culturelles, n’attend-on pas de l’école qu’elle donne toutes ses chances à chacun ? L’école n’est-elle pas la seule institution capable, par la transmission des savoirs, le développement de la motivation et des compétences, la mixité et des valeurs d’ouverture et de tolérance de lutter contre déterminisme social ? En théorie oui ! Mais il semble que le fatalisme l’emporte dans les faits. Les principes mêmes d’éducation ne parviennent pas à inclure tout le monde dans la réussite scolaire. La posture de l’enseignant délivrant des cours magistraux, les examens, devoirs, interrogations, notes et sanctions ont vite fait d’écarter les moins « armés » pour relever les défis. Par ailleurs, il est clair que de nombreux enfants n’ont pas les bonnes références culturelles et ce dès la maternelle ! Si les pédagogues partent du principe que tout le monde démarre sur une base de références communes, alors ils prennent le risque d’entériner très tôt les inégalités. « Dans une même classe de primaire, on peut avoir un élève qui a lu les Trois mousquetaires et un autre qui ne connaît pas Le petit Chaperon rouge » : cette affirmation de Maya Goret***, enseignante, illustre qu’il y a des classes où les enfants n’ont aucune référence culturelle. Malheureusement, bien souvent, l’approche pragmatique, compensatoire et sur-mesure que ces lacunes exigent n’est pas au rendez-vous : contraint d’avancer pour appliquer le programme, l’enseignant est aussi contraint de laisser quelques élèves de côté…
Un manque de mixité, facteur motivant dans les apprentissages
Au sein de l’école de la République, une classe doit être le lieu de toutes les mixités sociales : genres, milieux socio-économiques, origines géographiques, niveaux culturels… Qu’il soit d’origine modeste et peu lettré ou héritier d’un capital culturel plus riche, l’enfant a tout intérêt à côtoyer la différence. La mixité sociale à l’école favorise l’attention à l’autre et l’entraide constitue le fondement d’une société ouverte et tolérante. Et pourtant, ce beau principe de mixité est mis à mal et ne cesse de se dégrader dans les faits. On s’aperçoit que le brassage social, mesuré par l’indice de position sociale (IPS) baisse dans les établissements français*. Plus l’établissement a un IPS élevé, plus ses élèves réussissent. Or, ce sont les établissements privés qui ont les IPS les plus élevés.
Ce fait est corroboré par les chiffres suivants : 42,6 % d’élèves défavorisés sont accueillis dans l’école publique, contre 18 % dans le privé…** Cette ségrégation sociale entre le public et le privé n’œuvre pas pour diminuer les inégalités mais les accentue au contraire…
Les troubles spécifiques des apprentissages : autres causes d’inégalités scolaires
Dyslexie, dysorthographie, troubles de l’attention, hyperactivité… S’ils ne sont pas diagnostiqués et pris en charge, ces troubles des apprentissages ne cessent de creuser les différences de niveaux et de parcours scolaires dès le plus jeune âge. La lecture, étape complexe est aussi fondatrice et fondamentale : si l’enfant prend du retard sur la lecture, il part avec un handicap dans sa scolarité. L’Observatoire National de la Lecture avait démontré que, dans 85 % des cas, les élèves en échec scolaire avaient des difficultés en lecture par rapport à leur niveau ou à leur âge. Par ailleurs, il arrive bien souvent qu’un enfant qui a du mal à lire ou à comprendre suscite moqueries et stigmatisations, freinant encore plus ses progrès et inhibant ses efforts. D’où l’importance d’identifier, veiller et prendre en charge ces troubles spécifiques.
Au lycée la Jonchère, une approche pragmatique et sur-mesure des apprentissages
Peut-on parler d’inégalités scolaires au collège-lycée La Jonchère ? Même si les exigences d’apprentissage sont au rendez-vous, les critères de succès ne reposent pas sur des notes et des bulletins. L’idée est plutôt de valider les critères de bien-être et de bonheur des élèves au sein de l’école pour s’assurer de leur disponibilité et de leur motivation pour apprendre. Il est vrai que l’effectif réduit permet une attention particulière des enseignants sur chaque élève, dans une posture d’encouragement et de soutien. Ainsi, l’enseignant peut identifier les besoins et adapter les niveaux d’apprentissage à chacun. Cette approche pragmatique assume les différences de niveaux et les corrige en même temps. On peut dire aussi que l’école ne se positionne, ni se définit comme un établissement élitiste, aux conditions tarifaires disqualifiantes. Un système de bourse permet d’intégrer des élèves de catégories socio-professionnelles diverses, l’adhésion aux valeurs et au fonctionnement de l’école étant le critère primordial préalable à l’admission.
*L’IPS résume les conditions socio-économiques et culturelles des familles des élèves et permet de rendre compte des disparités sociales existantes entre établissements et au sein des établissements. Etude février 2022l’IPS.
** Ministère de l’Education nationale
*** France Culture – Inégalités scolaires, que fait l’Etat ?
Related Posts:
- Sévère ou trop gentil, qu’attend-on du « bon prof » ?
- Quels sont les différents types de difficultés scolaires ?
- Les bénéfices des échanges scolaires entre collèges
- Le syndrome de l'expatrié existe-t-il chez les…
- L'école classique est-elle responsable du mauvais…
- Les causes de l'ennui scolaire des élèves en France…





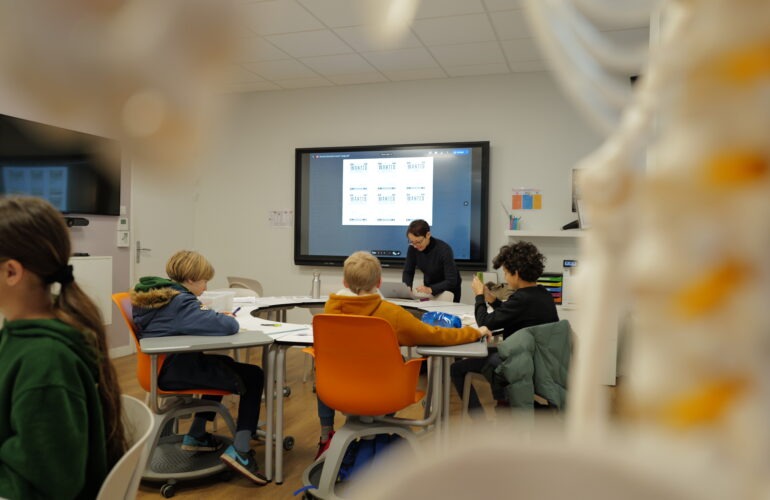

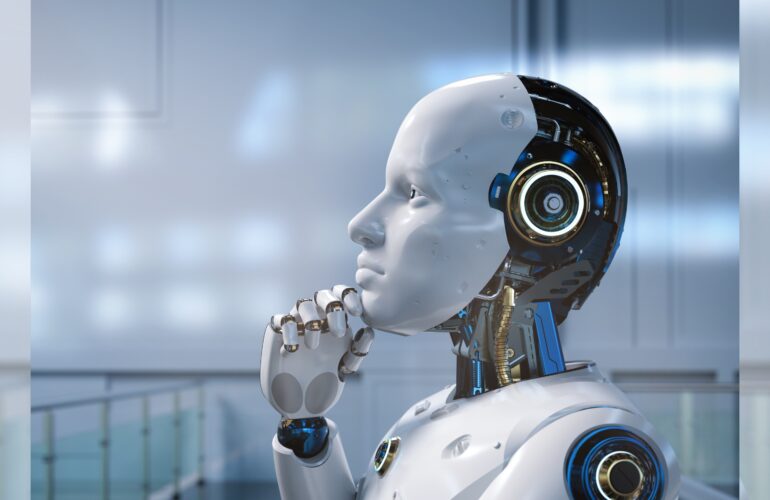
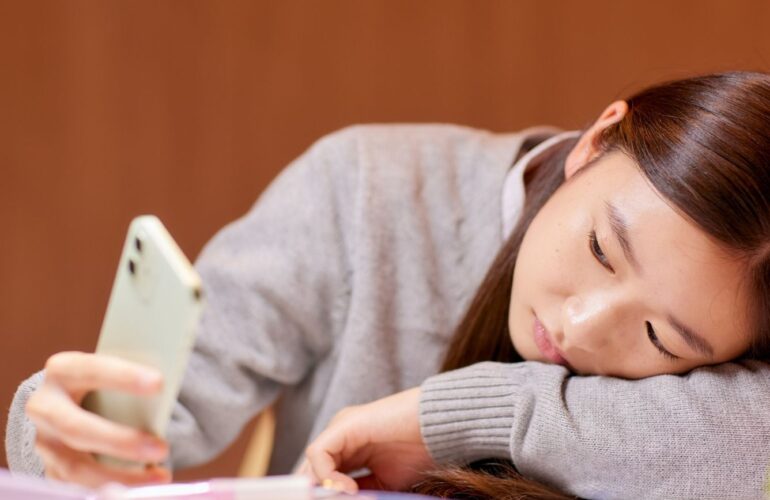



Le poids de l’origine sociale, plus lourd dans notre pays