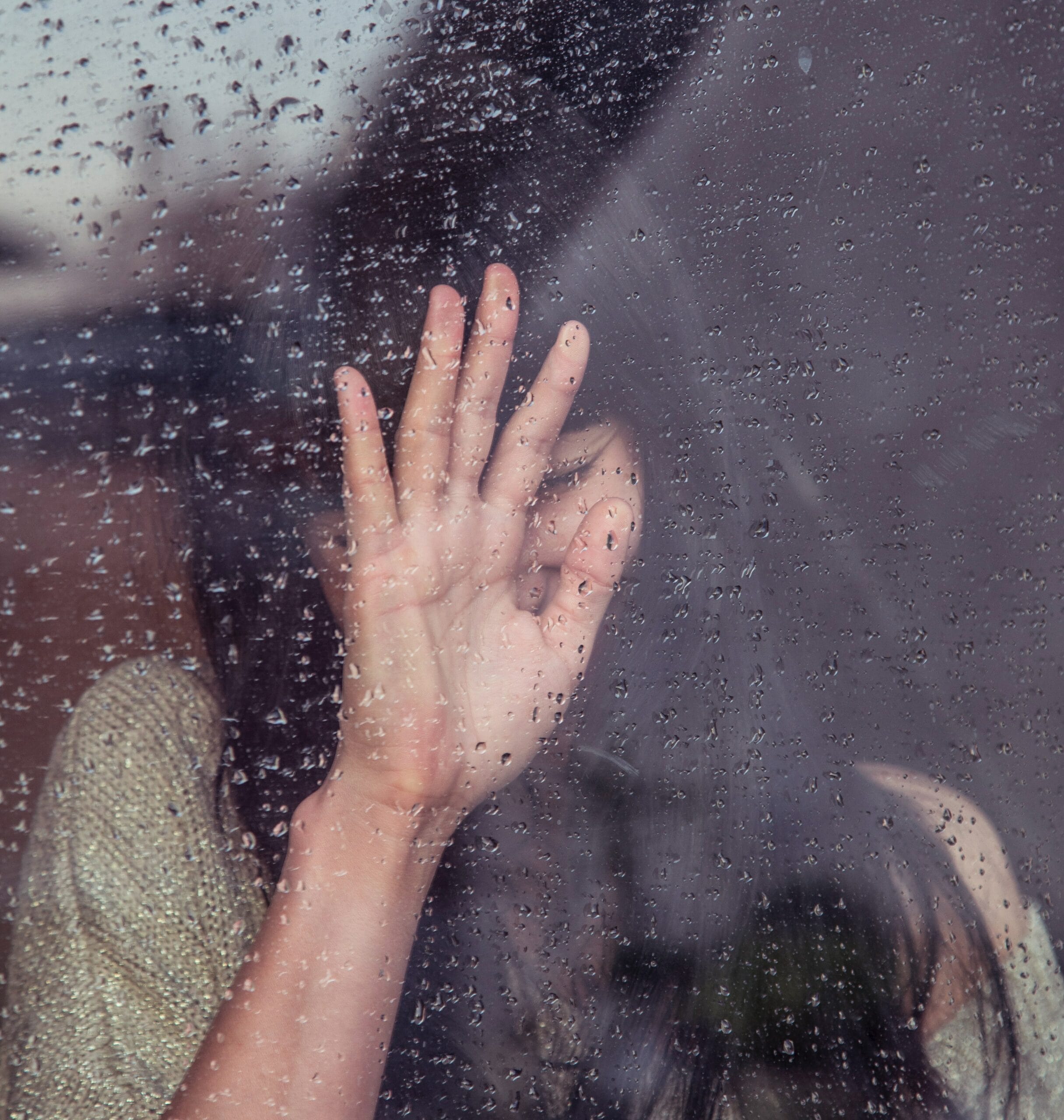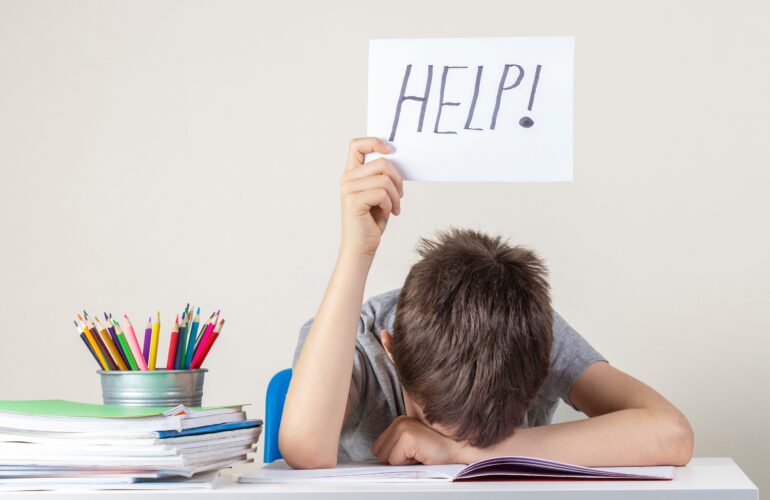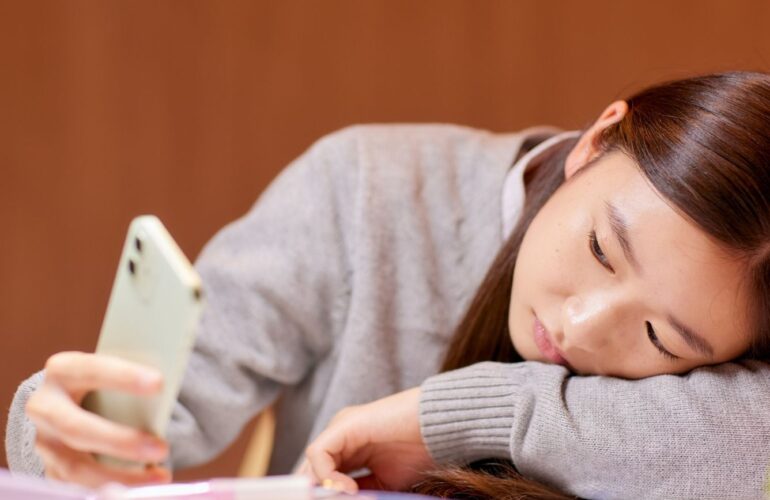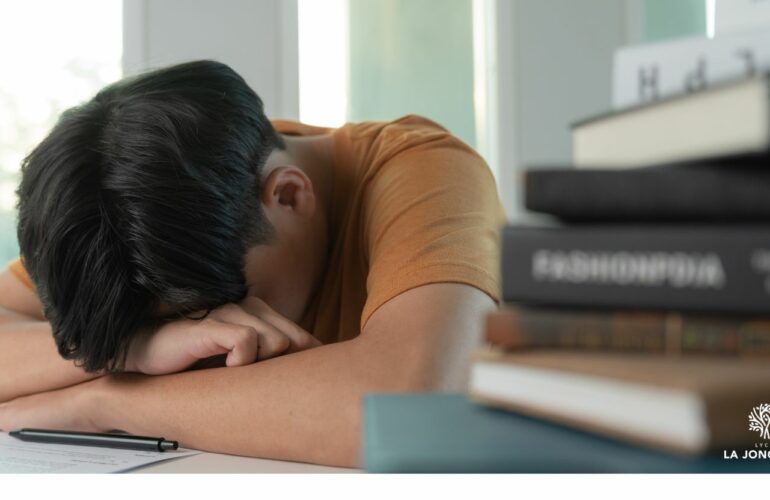Harcèlement scolaire : définition, chiffres et solutions
Au vu des conséquences graves qu’il peut provoquer, le harcèlement scolaire est un sujet pris très au sérieux depuis quelques années par les autorités éducatives. Qu’est-ce que le harcèlement scolaire ? Quels sont les facteurs qui le favorisent ? Comment en diminuer les risques au sein de l’école ? Quels sont les outils mis en place pour réagir lorsqu’une telle situation se déclenche ? On vous dit (presque) tout !
« J’étais enfant, j’étais petit, j’étais cruel » Le poème de Victor Hugo, Les crapauds, est une illustration édifiante de la cruauté enfantine : décrivant un groupe d’enfants martyrisant un pauvre batracien, le texte est fascinant par son réalisme sur l’inconscience de la violence et sur l’effet d’influence du groupe dans ses gestes meurtriers : « Et chacun d’eux, riant, – l’enfant rit quand il tue, – Se mit à le piquer d’une branche pointue, Élargissant le trou de l’œil crevé, blessant… » L’évocation de ces enfants acharnés sur une victime peut illustrer une scène de harcèlement scolaire, débouchant parfois, dans son plus grave développement, à une issue mortelle. Selon les associations de protection de l’enfance et l’IFOP 2021, près d’1 enfant sur 10 serait harcelé chaque année en France, soit 1 million d’enfants en tout, les violences se déroulant en majorité au collège (54 %) puis au primaire (23 %) enfin au lycée (13 %). 61% des enfants harcelés déclarent avoir des pensées suicidaires.
Plan de l'article
Le harcèlement a été défini officiellement par l’Éducation nationale « comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l’école. Elle est le fait d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre ». Les trois composantes du harcèlement sont aussi identifiées précisément par les autorités. Il s’agit de la violence – un rapport de force et de domination entre des élèves et une ou plusieurs victimes –, la répétitivité régulière des agressions durant une longue période, et l’isolement de la victime, affaiblie, se retrouvant dans l’incapacité de se défendre. Le harcèlement prend racine dans le rejet de la différence et sur la stigmatisation. Tout y passe ! L’apparence physique (poids, taille, couleur ou type de cheveux), le sexe, l’identité de genre (garçon jugé trop efféminé, fille jugée trop masculine, sexisme), l’orientation sexuelle ou supposée (homosexualité), un handicap (physique, psychique ou mental), un trouble de la communication qui affecte la parole (bégaiement, bredouillement), l’appartenance à un groupe social ou culturel particulier, des centres d’intérêts différents (un enfant préférant lire pendant la récréation peut être stigmatisé et moqué par exemple…) Les actes de harcèlement se manifestent ensuite par la violence physique, des bousculades, des coups, et des comportements plus subtils comme des critiques, des moqueries, de l’humour aux dépens de l’autre… Ces comportements pouvant bien sûr se prolonger en ligne – moqueries sur une discussion de groupes ou sur un réseau social –, on parle alors de cyberharcèlement.
Les ressorts du harcèlement : un besoin de pouvoir et de reconnaissance
À l’origine, on peut identifier un profil d’intimidateur caractérisé par un désir de dominer et de soumettre l’autre à travers une force physique, sociale ou psychologique. Cette volonté de dominer et ce goût du pouvoir le transforment en leader d’un groupe qu’il entraîne dans son action. L’intimidateur gagne ainsi en pouvoir et en popularité, ses suiveurs pensant être protégés et à l’abri en s’attaquant avec lui, à une victime. Et plus on se montrera persifleur, plus on gagnera des marques de respect et on se protégera soi-même des autres ! Chez les filles, le phénomène de « mean girls » (vilaines filles) en est l’illustration. Ce phénomène, aussi appelé « peste attitude » consiste à créer des bandes de filles populaires régnant sur leurs copines suiveuses et subjuguées. Les leaders font courir des rumeurs sur d’autres élèves qui se trouvent exclus du groupe et pour concrétiser cette exclusion, la mécanique du harcèlement se met en place. Il est avéré que les enfants moteurs dans le harcèlement expriment toujours une souffrance narcissique. À travers leurs agissements néfastes, ces jeunes cherchent à attirer l’attention et à dissimuler leurs failles, se forgeant un personnage de composition, le plus souvent de leader, pour compenser un manque de confiance en eux.
La méthode de la préoccupation partagée (MPPP) : vigilance collective et bienveillance
Le phénomène du harcèlement a fait l’objet de recherches aboutissant à des solutions intéressantes en termes de prévention. Parmi elles, la méthode de la préoccupation partagée (MPPP). Créée en 1970 par Anatol Pikas, professeur de psychologie suédois, la MPPP part du principe que plus le harcèlement est repéré rapidement, plus il est facile d’y remédier. Elle repose aussi sur l’idée que plus de personnes sont alertées et formées à la prévention au sein de l’école, plus la situation peut être prise en charge de façon efficace. C’est le cas des professeurs, infirmiers, CPE, équipe de direction… Mais Anatol Pikas va plus loin : il renforce la prévention avec la désignation d’élèves ambassadeurs chargés d’alerter comme des vigies !
Dans le cadre du protocole Pikas, les harceleurs identifiés sont invités à s’entretenir individuellement avec un adulte référent. Plutôt que sanctionner, ce dernier doit conduire l’élève à se responsabiliser et l’inciter à trouver des solutions pour mettre fin à la situation délétère. Cette démarche a pour but de déclencher l’empathie, mais aussi et pourquoi pas, une prise de conscience, par le harceleur, que son attitude n’est pas motivée par de bonnes raisons. Aucune sanction n’est prise dans ce cadre contre lui lors de ce premier entretien. Il s’agit plutôt d’installer une relation de confiance et de bienveillance. Ce n’est que dans un deuxième temps que le harceleur sera sanctionné s’il récidive malgré tout…
Prévention et sanction du harcèlement scolaire en France
Inspiré par la méthode Pikas, le programme de prévention du harcèlement « pHARe » a été mise en place au sein des écoles et collèges à la rentrée 2021. Il est fondé, entre autres, sur la mesure du climat scolaire, la formation d’une communauté protectrice de professionnels et de personnels pour les élèves, l’association avec les parents, le suivi de l’impact des actions, la mise à disposition une plateforme dédiée aux ressources… Au cœur du programme pHARe, une plateforme digitale est dédiée à la lutte contre le harcèlement regroupant tous les contenus éducatifs destinés aux ambassadeurs collégiens, aux élèves du CP à la 3e et aux adultes (parents, personnels), les outils de suivi pour les responsables de l’établissement et les superviseurs académiques, une cartographie des actions à mener pour lutter contre le harcèlement et le cyberharcèlement. Au sein des académies, 337 référents harcèlement sont répartis sur tout le territoire pour sensibiliser, accompagner et former. Ils supervisent et coordonnent les actions pour résoudre les situations de harcèlement signalées, grâce une plateforme téléphonique ou grâce aux relais locaux. Ils accompagnent et facilitent le dénouement en étant un interlocuteur privilégié des familles. Deux numéros d’écoute ont été mis en place en cas d’urgence : le 3020 et le 3018 (pour le cyberharcèlement). Par ailleurs, la loi française du 2 mars 2022 sanctionne lourdement le harcèlement scolaire qui peut être puni de 10 ans de prison en cas de suicide ou tentative de suicide de la victime.
Qualité de vie à l’école : un facteur important pour limiter les risques de harcèlement
Comme le préconise la méthode Pikas, instaurer un climat de vigilance dans la bienveillance est capital pour prévenir du harcèlement. Au-delà de ce constat, plus l’ambiance de l’école est agréable, moins les relations entre élèves seront conflictuelles et plus le risque de déraper vers du harcèlement sera réduit. Le programme international de l’OCDE (Pisa) a d’ailleurs prouvé « qu’un climat scolaire serein influence la réussite des élèves, fait diminuer les problèmes de décrochage professionnel des enseignants, a un impact sur la sécurité en milieu scolaire, la réduction des conduites à risques, des micro-violences et du harcèlement, de l’absentéisme et du décrochage ». Ce sont les adultes qui doivent créer les conditions pour que l’ambiance dans l’établissement soit propice à de bonnes relations entre les élèves et entre les adultes et les élèves. Un climat scolaire plus inclusif et plus protecteur exige une implication résolue à tous les niveaux de l’institution scolaire. Il ne s’agit pas seulement de lutter contre les violences, mais aussi de faire de chaque établissement un endroit sûr où chaque élève puisse se construire sereinement.
Au Lycée La Jonchère, des outils concrets de prévention des conflits et du harcèlement
Le climat scolaire est d’emblée favorable à une bonne entente entre les élèves au Lycée La Jonchère. En effet, le petit effectif de l’école instaure une proximité entre personnel pédagogique et élèves, permettant d’identifier rapidement les conflits, et d’aider à surmonter les émotions négatives. Mais surtout, la mise en place d’outils et de process très concrets de résolutions et de communication non violente ont été installés. Tous les personnels et élèves y sont formés et les utilisent régulièrement. Il s’agit du process de médiation déclenché à la demande des élèves qui en ressentent le besoin pour calmer un conflit, le principe du mentoring permettant la coopération entre élèves sur des apprentissages mais aussi pour canaliser les comportements, et la communication Gordon, pratique d’écoute active et de reformulation des émotions et besoins de l’autre pour mieux le comprendre dans une approche «gagnant-gagnant». Tous ces moyens ont été actionnés et on fait leur preuve au sein du Lycée La Jonchère où les conditions d’entente font partie de l’ADN de l’école !