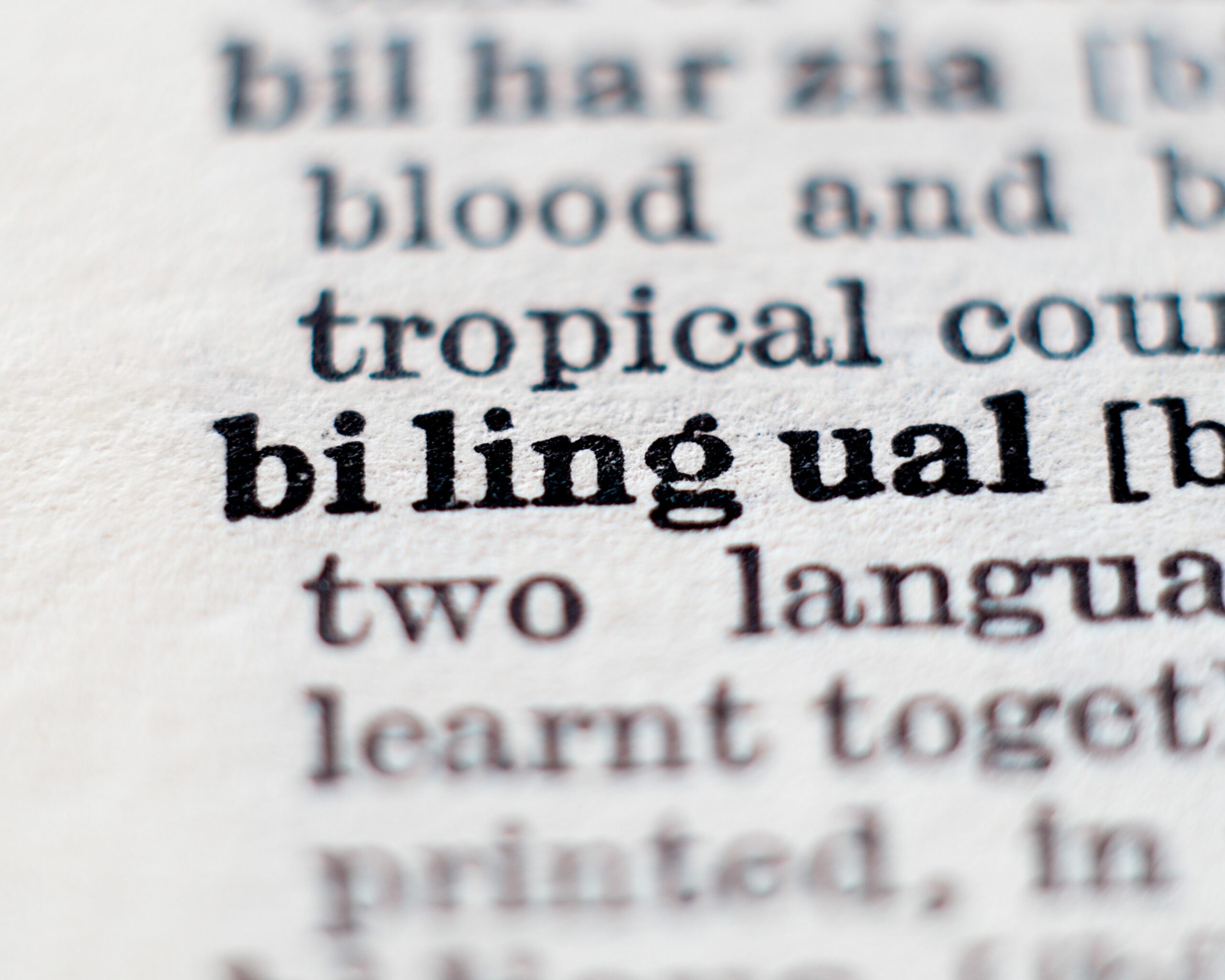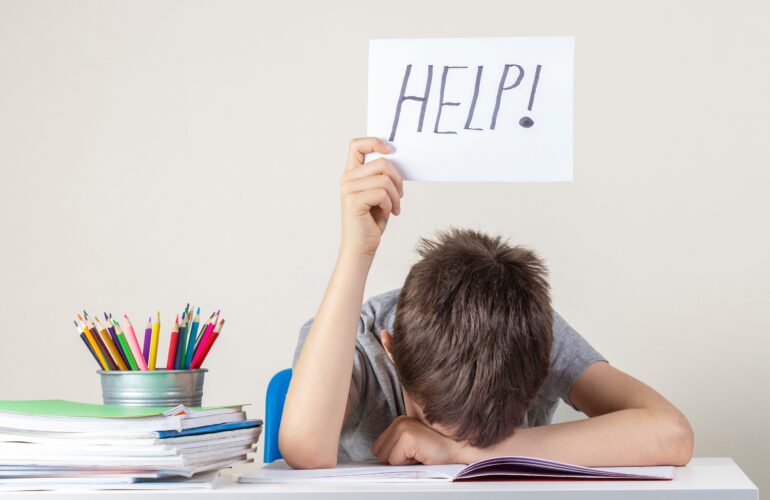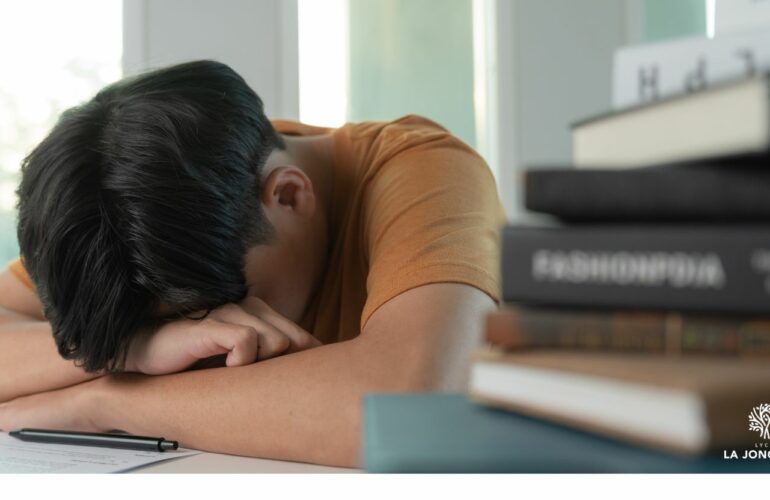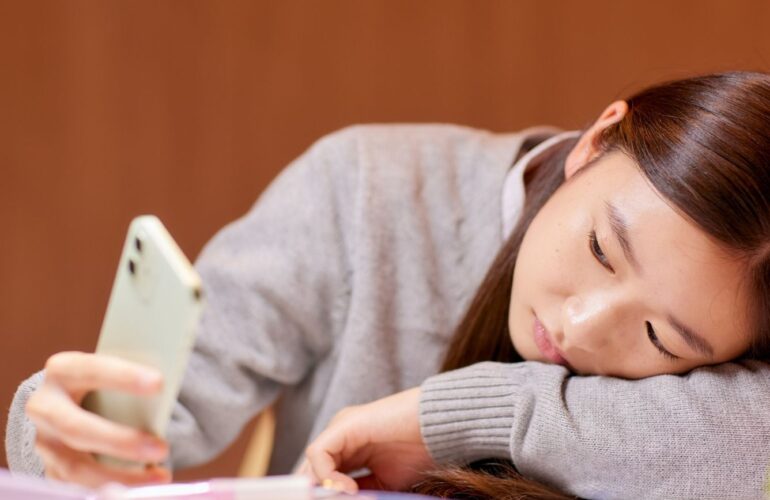Les différents types de bilinguisme chez l'enfant : comment consolider les acquis ?
Nous l’avons déjà vu, apprendre des langues étrangères très jeune est une grande opportunité pour l’enfant et l’adulte en devenir : ouverture au monde, sentiment de confiance et de sécurité global, potentiels pour l’avenir professionnel et, plus largement, un développement des capacités cognitives important (1). La question est de savoir comment entretenir le bilinguisme ou multilinguisme de l’enfant pour qu’il en exploite tous les bénéfices !
Plan de l'article
Précoce, consécutif, tardif : les différents types de bilinguismes
On ne naît pas bilingue, on le devient… à différentes périodes de sa vie, dans des contextes particuliers et à des rythmes différents. C’est pourquoi on parle principalement de trois types de bilinguismes : le bilinguisme précoce, le bilinguisme précoce consécutif et le bilinguisme tardif.
Le bilinguisme précoce avec une famille ou un environnement bilingue
Lorsque l’enfant grandit dans une famille bilingue, il est naturel pour lui de comprendre deux langues différentes, comme s’il avait deux langues maternelles. S’il vit dans un pays étranger tout petit, il acquerra aussi naturellement la langue du pays qu’il découvrira à l’école, et dans la vie courante. Ce bilinguisme acquis précocement semble être la plus simple façon d’intégrer différentes langues et la plus évidente pour parvenir à les approfondir et à les consolider par la suite. Dans cette configuration, l’enfant peut devenir parfaitement bilingue.
Le bilinguisme consécutif à partir de 3 ans
On parle de bilinguisme précoce consécutif lorsque l’enfant aborde une langue étrangère vers l’âge de 3 ans, à l’occasion d’un changement de pays ou au contact permanent d’une personne d’une langue native différente de la sienne par exemple. Il est intéressant de noter qu’à cet âge, l’apprentissage se fait plus rapidement qu’à l’adolescence car l’enfant réactive les mêmes mécanismes mis en place lors de l’apprentissage de sa première langue maternelle. Ce phénomène est connu comme étant le « transfert dans l’apprentissage d’une nouvelle langue », concept qui a été développé par des spécialistes du développement du langage (2).
Le bilinguisme tardif : à partir de 6 ans
Le bilinguisme tardif, quant à lui, se produit au moment où l’enfant apprend une deuxième langue à partir de l’âge de 6-7 ans (en classe de CP) ou plus tard, au collège. L’avantage est qu’il aborde la langue étrangère dans sa structure grammaticale et à travers l’écriture et la lecture. Ces acquis solides ne garantissent toutefois pas une assimilation parfaite de la langue : si cette dernière n’est pas soutenue par une pratique régulière, l’enfant pourra avoir des difficultés à atteindre le niveau de maîtrise que celle des enfants bilingues précoces. Aussi, le manque d’entraînement oral aboutit à des difficultés de prononciation, puisqu’il ne « baigne » pas dans l’environnement étranger. C’est ainsi que s’installent les accents que l’on perçoit lorsqu’une personne ne parle pas sa langue maternelle.
Quelques risques de perdre son bilinguisme
Généralement, un enfant a besoin d’être exposé à une deuxième langue au moins 30 % de son temps d’éveil pour pouvoir être considéré comme bilingue. Ce chiffre montre qu’il existe une langue majoritaire dominante et une autre plus en retrait à laquelle on se doit d’être attentif pour conserver le niveau de bilinguisme.
Les risques de perdre la richesse de sa langue minoritaire sont liés à plusieurs facteurs : l’enfant quitte le milieu étranger et « se replie » sur sa seule langue majoritaire, perdant la pratique de la deuxième. Plus tard, l’adolescent peut se sentir inhibé socialement par son bilinguisme. Il n’est pas exclu qu’il se sente « différent » par rapport à ses camarades monolingues et n’assume pas cette différence. Résultat : une réticence à parler sa deuxième langue, comme pour en effacer la particularité. Les relations avec la famille influencent également la pratique du bilinguisme. Si celles-ci ne sont pas au beau fixe, il peut y avoir un effet de rejet de la langue du parent en conflit. Le risque de « perdre » la richesse du bilinguisme est réel au moment de cette période délicate de la vie. Un autre risque est de reposer sur les acquis de la petite enfance, ne pas approfondir et mal connaître la langue minoritaire dans ses dimensions syntaxiques. Parfois, certains enfants bilingues ne parviennent pas à de bons résultats scolaires dans la matière de la langue en question par manque de travail. Pour pallier ces difficultés de consolidation, plusieurs pistes sont préconisées par les spécialistes.
Un engagement en famille
Élever un enfant dans deux ou plusieurs langues demande en réalité un effort soutenu. On peut même dire qu’il s’agit d’une adhésion de toute une famille à un projet ! Pour consolider les acquis du bilinguisme, l’idéal est de créer les conditions de pratique mais aussi pour étudier et enrichir les deux langues. Il est aussi très pertinent d’aider l’enfant à se construire une identité à partir de ces deux langues et de ces deux cultures à égalité.
La stratégie linguistique la plus connue et répandue est celle du « One Person, One language » (OPOL). Elle permet à l’enfant de distinguer clairement la différence entre les langues dont il dispose. Selon cette méthode, chaque parent parle sa langue native de façon constante et exclusive au sein de la famille – avec papa on parle l’anglais, avec maman, le français par exemple. Cet engagement est important car elle permet l’immersion en continu de l’enfant, sans effort. Elle évite les risques de confusion et de code mixing . Selon qu’il s’adresse à l’un ou l’autre parents, l’enfant sait qu’il ne peut pas panacher les langues, la distinction est pour lui beaucoup plus limpide. Cette méthode exige de la persévérance de la part des parents. Hors de la maison, dans son environnement social et amical, on peut imaginer que ce n’est pas simple de parler une langue étrangère à son enfant !
« Muscler » la langue minoritaire
Pour « travailler » la deuxième langue, enrichir le vocabulaire, appréhender la structure grammaticale et les sonorités, il est conseillé d’y consacrer des moments réguliers, dès le plus jeune âge de l’enfant. Une lecture expressive à voix haute, le partage d’un extrait de films ou d’une courte vidéo éducative tous les soirs sont d’excellents moyens d’instaurer le plaisir de comprendre et l’envie d’approfondir la langue… Il suffit de quelques minutes pour se consacrer à ce « rendez-vous », en dehors des heures de travail et des devoirs. Quand l’enfant est plus grand, lire les versions originales des grands classiques est bien sûr incontournable : « Harry Potter » en anglais, « Don Quichotte » en espagnol, « Le joueur d’échec » en allemand par exemple… Et bien sûr, ne jamais déroger aux versions originales des films sans sous-titres.
Une autre piste consiste à extraire l’enfant de l’usage de la langue quotidienne pour l’encourager à s’exprimer sur des concepts plus abstraits. Les jeux qui développent l’imaginaire et l’expression sont les meilleurs alliés. Vous pouvez utiliser des images à partir desquelles l’enfant racontera une histoire avec un début et une fin, ou lui demander de résumer ou synthétiser des notions de mathématiques ou un cours d’histoire dans la langue non majoritaire. C’est une belle façon de le rendre « actif » dans sa deuxième langue.
Célébrer l’« autre » culture
Conserver son bilinguisme passe aussi par la connaissance du pays de la langue pratiquée : culture, coutumes, gastronomie… Pour faciliter l’identification de l’enfant à cette culture, il ne faut jamais négliger de le mettre en contact avec celle-ci par des séjours réguliers dans le pays d’origine, des connexions fréquentes avec la famille à l’étranger… La cuisine est aussi un excellent vecteur de la culture. Organiser des repas avec les spécialités locales, le partager avec son entourage ne peut que développer un sentiment de fierté et d’appartenance chez l’enfant. Ainsi, l’immersion culturelle l’aide à s’exprimer avec la même précision et la même finesse que dans sa langue majoritaire.
Le bilinguisme à La Jonchère
Sans être une école bilingue anglais, le lycée La Jonchère encourage fortement l’enseignement de langues étrangères par des professeurs natifs. Ainsi, l’ apprentissage très soutenu de l’anglais est une réalité depuis plusieurs années, dès la 6ème. L’apprentissage de la langue repose sur des méthodes et outils très variés et incitatifs : outils numériques, jeux de rôles, jeux de société, challenges, décryptage de l’actualité. Des séminaires sont organisés régulièrement pour créer des conditions d’immersion. Au-delà de l’aspect linguistique, c’est la richesse de la culture, des usages de la langue qui sont transmis par des professeurs ayant des origines, accents et cultures distincts. Certaines séances de sport, arts, histoires et géographie sont enseignées en anglais. On peut parler d’apprentissage de l’anglais par immersion au lycée La Jonchère, les enseignantes ayant à cœur de s’adresser aux élèves en anglais à tous les moments de la vie de l’école.
- “The relation of bilingualism to intelligence. Psychological Monographs”, Peal, E. & Lambert, W. E. (1962)
2. “The cross-lingual dimensions of language proficiency : implications for bilingual education and the optimal age issue », Jim Cummins(1980).
Related Posts:
- Quels sont les différents types de difficultés scolaires ?
- Changement d’école : comment faciliter l’intégration…
- Le syndrome de l'expatrié existe-t-il chez les…
- Comment un enseignant bienveillant peut-il changer…
- Comment réussir son entrée au lycée ?
- Fin de CM2 : comment bien préparer le passage en 6ème ?