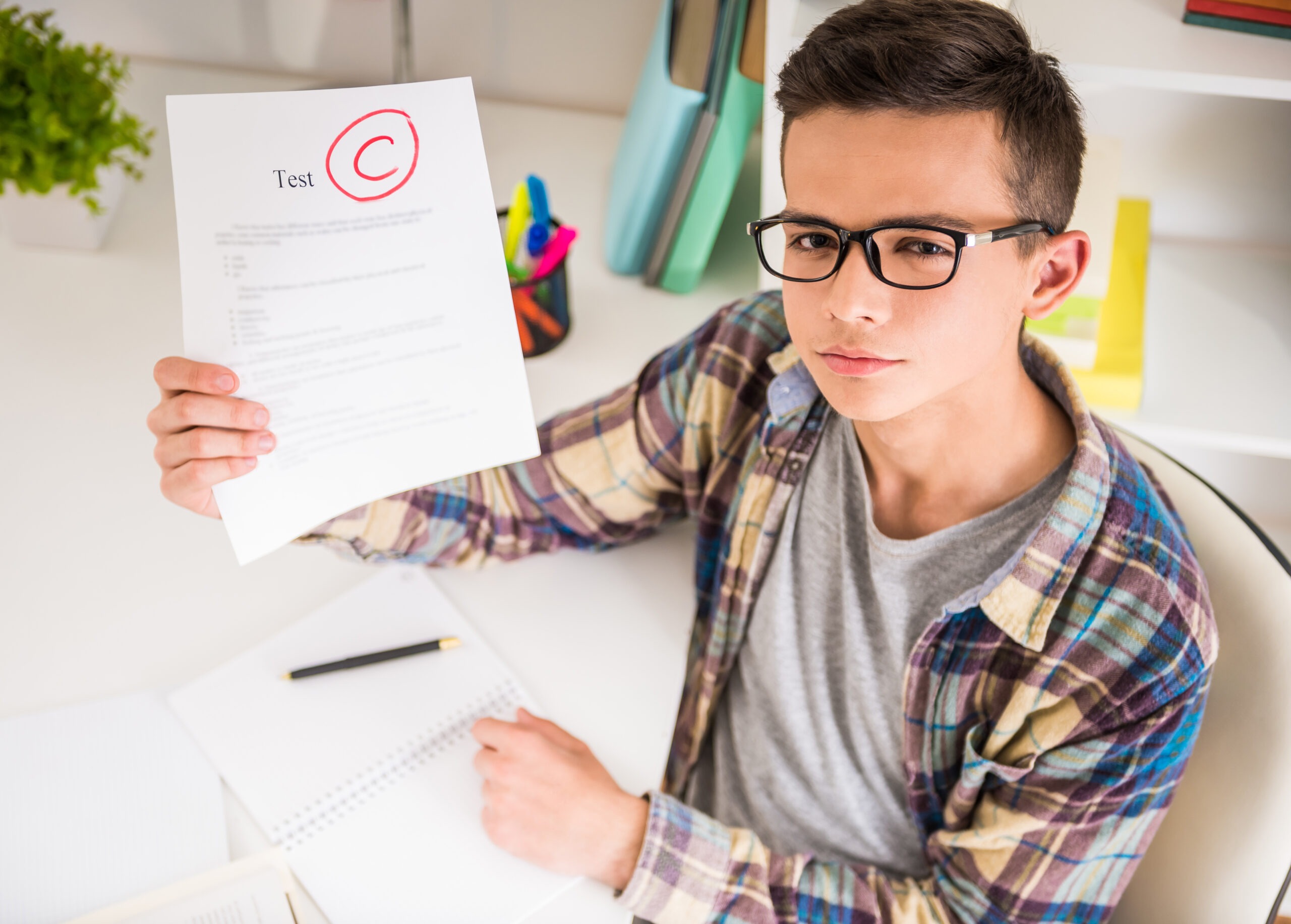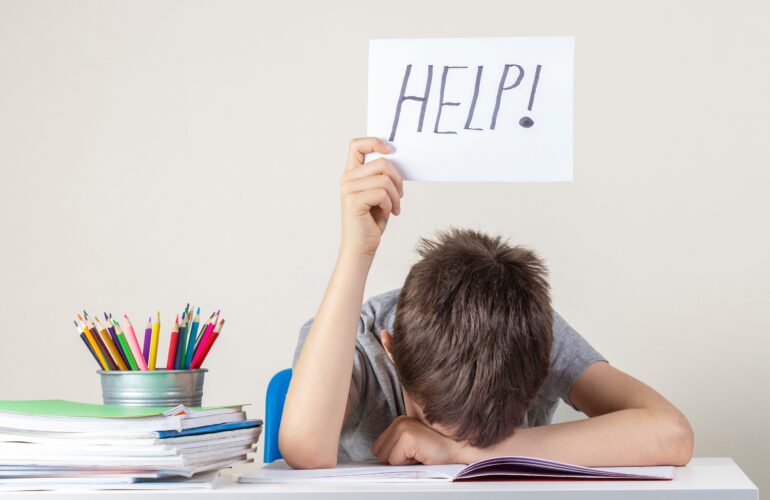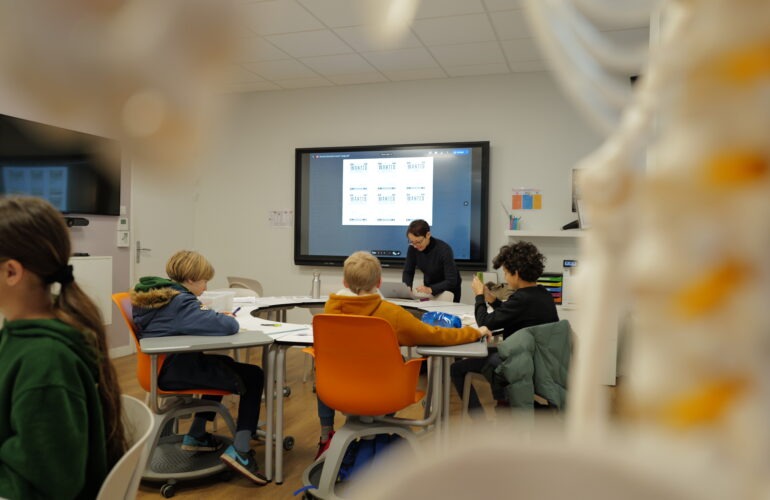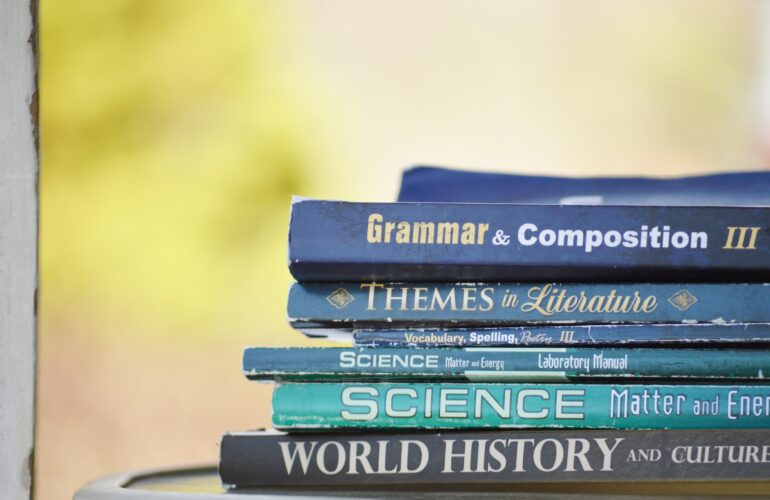Notes à l'école : faut-il les supprimer ?
Certains la fustigent, d’autres l’applaudissent. Depuis sa création, la note divise ! Considérée comme un repère indispensable pour les élèves d’un côté, ou comme une injuste et stérile évaluation de l’autre, la note scolaire s’expose au débat depuis des décennies au sein de l’éducation. Pourtant, inhérente au système scolaire français, elle est totalement intégrée par des générations d’élèves, de professeurs et… de parents ! Les bonnes notes ne sont-elles pas des monnaies d’échanges pour obtenir permissions de sorties, vêtements convoités, récompenses… ? Référentiels rassurants ou au contraire irritants pour les parents, les notes jouent depuis toujours un rôle de curseur plus ou moins angoissant pour tous les élèves des collèges et lycées de France, créant un sentiment d’appréhension (et parfois de phobie scolaire) – la fameuse peur de la mauvaise note ! – dans la majorité des cas. Cette pression signe-t-elle l’échec du système de notation au sein de la scolarisation ? Ou au contraire un booster pour les apprentissages ? A quoi servent les notes ? Quels en sont les bons côtés ? Les moins bons ? Peut-on remplacer la notation scolaire par un autre système ? Ou tout simplement supprimer les notes ?
Plan de l'article
L’histoire de la notation scolaire est récente. A la fin du XIXe siècle interviennent les grandes réformes du système scolaire français. En 1886, sous l’impulsion de Jules Ferry, est votée la loi sur l’organisation de l’enseignement primaire, dite loi sur la laïcité, qui confie l’enseignement public exclusivement à un personnel laïc. Dans la mouvance de ces grandes réformes intervient celle du système de notation : le système de la note sur 20 au baccalauréat est mis en place en 1890. C’est donc l’école laïque qui invente une forme d’évaluation par la notation. En effet, l’école de l’ancien régime appliquait un système d’évaluation uniquement oral. Même au baccalauréat créé en 1808, le jury rendait son verdict avec des boules de couleurs : blanches pour neutre, rouges pour favorables, noires pour défavorable. Au primaire, la note sur 10, aussi généralisée par Jules Ferry est utilisée pour le certificat d’étude. On peut dire que, quel que soit le système religieux ou laïc, c’est l’idée de compétition, à travers la récompense, qui structure les apprentissages car elle est censée favoriser l’émulation des élèves.
Un attachement indéfectible à la note chiffrée : avantages
Quels sont les avantages de la note ?
1) Un repère par rapport aux camarades de classe
Selon une étude de l’inspection générale de l’Education nationale (La notation et l’évaluation des élèves éclairées par des comparaisons internationales, 2013), le système avec notation chiffrée est massivement reconnu par les élèves comme un bon moyen pour se situer les uns par rapports aux autres et savoir « ce qu’ils ont appris ». Les notes, « c’est plus précis », « on se repère mieux », disent-ils. Toutefois, ils expriment aussi le fait que ce sont les « appréciations écrites » des professeurs qui leur permettent de prendre conscience de leurs progrès et surtout de repérer ce qu’ils doivent encore travailler et améliorer. Les notes donnent donc le niveau, les appréciations analysent les réussites et les obstacles.
2) Les notes sont précises
La perception de la note est différente selon les performances et compétences des enfants. Pour les élèves en difficulté, les notes, « c’est cassant », « on ne comprend pas ce qui ne va pas, on sait simplement qu’on est nul ». À l’inverse, les élèves qui réussissent bien à l’école, qui sont à l’aise, préfèrent les notes à tout autre système d’appréciation ou d’évaluation : ces notes, parce que « plus précises », les motivent pour encore améliorer leurs résultats ; « on veut passer de 16 à 17, ou 18… », ce que ne permettrait pas, disent-ils, l’évaluation par les lettres de type A, B, C.
3) Un référentiel facile et connu
Du côté des parents, la note est restée un référentiel connu et facile à interpréter, dès l’école primaire, pour avoir une visibilité sur les progressions. Avec le relevé de notes ou bulletin trimestriel qui vient tout au long du cursus de l’élève rythmer l’année scolaire. La notation serait donc nécessaire pour l’élève lui-même, qui a besoin d’être confirmé dans les progrès et pour les parents, qui ont besoin de savoir si tout va bien. Mais la note n’aurait-elle pas l’inconvénient de « figer » l’élève dans une image de bon ou de mauvais élément, sachant qu’elle est considérée comme « stressante » par la majorité des élève
Stigmatisation et caractère aléatoire : les inconvénients de la note
1) Un système stérile de sélection
Si le débat sur la note est apparu, c’est qu’elle ne semble pas pouvoir contrer l’échec scolaire… ce serait même le contraire ! Historiquement tournée vers la sélection, la note scolaire répondait aux exigences d’un système éducatif élitiste. Au fil des années, l’obsession du classement à laquelle elle répondait a créé, dès l’école élémentaire, une très forte pression scolaire et stigmatisé des élèves qu’elle a enfermé dans une spirale d’échec scolaire. Dans ce cas, démotivantes, les mauvaises notes sont vécues comme une sanction et n’apportent pas les clés d’une progression. Et il est vrai que partant du principe qu’elle accentue la compétition, les détracteurs de la notation pensent qu’elle ne fait qu’illustrer et entériner les inégalités sociales. On rejoint aussi l’idée que la note finit par stigmatiser un élève, en lui apposant une étiquette attestant de sa bonne ou de sa mauvaise « qualité » tout au long de sa scolarité.
2) La note est subjective
Par ailleurs, une note seule peut-elle refléter de manière juste le niveau et la motivation d’un élève ? Une étude a démontré que l’écart de notes entre deux correcteurs d’une même copie du baccalauréat va jusqu’à 9 points en mathématiques et 13 points en français. (Etude Laugier & Weinberg, 1936). Une autre étude menée à la même période par des historiens prouve qu’un même correcteur à un an d’intervalle modifie le résultat attribué à une copie, dans la moitié des cas. C’est pourquoi la justesse et la fiabilité de l’échelle de notation sur 20 du barème, ainsi que la fiabilité de la note chiffrée ont été remises en cause. Globalement, les recherches en docimologie ont montré que les notes dépendent « non pas de la personne évaluée mais de celle qui évalue » (Pierre Merle, sociologie de l’évaluation scolaire, 1998). Ce constat a fait dire à Philippe Meirieu, professeur émérite en sciences de l’éducation à l’Université Lumière-Lyon 2 que « la notation traditionnelle est le système d’évaluation le plus approximatif, le plus laxiste et le moins exigeant qu’on puisse imaginer » !
L’évaluation lettrée, un système alternatif plus « doux » d’évaluation
Après mai 68, une circulaire avait recommandé de remplacer l’évaluation chiffrée par des appréciations globales accompagnée d’une notation du type A, B, C, D, E comme dans le système anglo-saxon. Très rapidement, en 1971, l’administration scolaire décide de revenir à la notation chiffrée de 0 à 20. Aujourd’hui, certains enseignants préfèrent néanmoins utiliser les lettres A pour très satisfaisant, B satisfaisant, C moyen, D insuffisant, E échec. Psychologiquement moins rude, ce système continue toutefois de s’inscrire dans la même logique que la note chiffrée, en apposant des déclinaisons et des niveaux avec des plus et des moins (A +, A-…). Nous en revenons toujours à un système de notation… déguisé !
L’évaluation par compétences, une alternative récente
L’évaluation par compétences a été mise en place sur la base d’un socle commun de connaissances et de compétences mis en place à la rentrée 2016. Le principe est qu’il n’y a plus de note chiffrée : pour un devoir ou contrôle, les professeurs ne mettent plus de points et choisissent un certain nombre de compétences. Ainsi, sur un même devoir, ils peuvent évaluer jusqu’à six ou sept compétences, selon le référentiel de compétences et le type de devoir. L’évaluation par compétences a beaucoup progressé dans l’enseignement primaire et en collège avec notamment sa prise en compte dans le Diplôme national du Brevet.
Les compétences à évaluer sont par exemple : mémoriser, chercher, raisonner, représenter, communiquer… à évaluer avec des objectifs différents sur quatre niveaux : débutant, apprenti, confirmé, expert. Ensuite, des compétences transversales sont ajoutées : écoute et respect des autres, travail en équipe, travail personnel et organisation, participation, implication, prise d’initiative. Ce travail d’évaluation a été mis en place pour être « plus constructif et plus individualisé sans être moins exigeant et complémentaire au système de notes » selon le directeur général de l’enseignement scolaire de l’époque, Jean-Michel Blanquer. Mais il peut sembler complexe et long à mettre en œuvre, notamment au sein de classes aux effectifs surchargés.
Au Lycée La Jonchère : une auto-évaluation accompagnée et une émulation positive
Nous l’avons vu, la note est centrale dans la trajectoire scolaire de chaque élève et résiste à beaucoup de remises en question au fil des années. Au collège et lycée alternatif La Jonchère, nous souhaitons que les élèves apprennent, progressent, se sentent bien en classe et s’entraident. L’établissement reprend à son compte l’idée que l’adolescent est une personne intelligente et autonome qui a besoin de soutien et de bienveillance pour s’épanouir. C’est pourquoi les enseignants, tout en étant exigeants dans la transmission des apprentissages, ne donnent ni sanction ni notation. Les élèves ne subissent aucune pression par rapport à des contrôles, devoirs sur table, examens et compétition par la note. En revanche, chaque séance de travail est consignée dans un “rapport de cours” sur lequel l’enseignant évalue le pourcentage d’acquisition de la notion apprise, tout en décrivant le comportement de l’enfant lors de la séance. Chaque semaine, un point sur la validation des acquis et le comportement est effectué entre un enseignant et chaque élève pour soutenir, clarifier, expliquer les progrès réalisés ou à accomplir à tous les niveaux de compétences. Ainsi, l’enfant peut se repérer par rapport à ses apprentissages et se sent soutenu et encouragé individuellement. Les élèves du brevet sont entraînés par des brevets blancs et se repèrent par rapport aux corrigés et retours des enseignants. Pendant la préparation des examens, il peut arriver que certains élèves ressentent le besoin d’avoir une note. Les enseignants du Lycée La Jonchère répondent alors à ce besoin, mais uniquement à la demande de l’élève.
Quant à l’émulation, elle est créée par l’organisation de challenges par équipes mixant âges et niveaux : chaque équipe remporte des points grâce au travail et efforts réalisés par chacun de ses membres. Une grande finale est organisée à la fin de la période du challenge créant ainsi une émulation très positive !